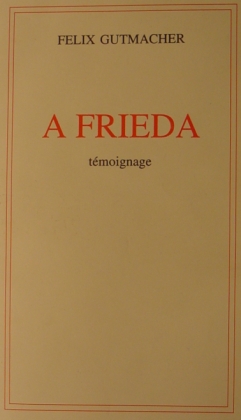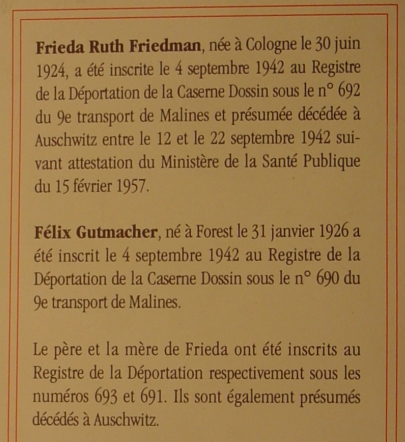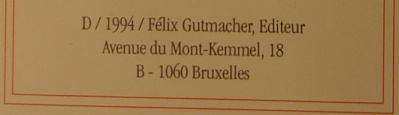|
|
|
Gutmacher, Félix - A Frieda. Témoignage, Bruxelles, Félix Gutmacher, 1994, 44 p. |
|
Que ce témoignage soit également un hommage à mon cher professeur de mathématiques de l'Athénée royal de Bruxelles* Monsieur Marcel Dupont, ainsi qu'à tous mes anciens condisciples de classe qui s'associèrent à lui dans celte périlleuse entreprise de secours par l'envoi d'un colis qui a contribué à me sauver la vie. Cela, je l'appris à mon retour et est relaté dans l'ouvrage autobiographique de Monsieur Dupont en ces termes : « J'avais reçu par
des voies détournées le message d'un élève juif qui, à la suite des
ordonnances allemandes, avait été forcé de quitter l'athénée au cours
de la troisième. Du camp de concentration où il « avait été déporté,
il m'adressait un S.O.S. m'implo rant de lui faire parvenir
clandestinement un colis susceptible de lui sauver la vie. Je m'activai
aussitôt et l'idée me vint de lire son appel à ses anciens
condisciples. C'était hasardeux, mais j'avais confiance en mes jeunes
gens. Ils s'associèrent unanimement à mon initiative ». (La Ligne
droite, Hommage également à
ce cher André De Rae! auquel je voue une profonde reconnaissance. * Aujourd'hui Athénée royal Jules Border |
|
Ce jour-là, c'était le 4 septembre 1942. |
|
J'avais seize ans et je m'ennuyais. Les Allemands avaient interdit aux enfants juifs la fréquentation des écoles. Je décidai de rendre visite à un camarade de mon âge qui habitait non loin de chez moi. Il s'appelait, si mes souvenirs sont bons, David Glowiczower dont les parents étaient connus dans le quartier comme de bons boulangers juifs. Ils habitaient rue du Vautour à Bruxelles. Tout en flânant par un doux après-midi de fin d'été, sous un soleil resplendissant qui redonnait un peu d'espoir, j'étais arrivé à proximité de leur maison et m'apprêtais à sonner à la porte lorsque j'aperçus dans le sens opposé une voiture allemande découverte, avançant lentement, occupée par quatre militaires qui visiblement cherchaient le numéro d'un immeuble. Comme je portais l'étoile de David, je jugeai préférable de faire demi-tour, comme si de rien n'était, avant qu'ils ne parviennent à ma hauteur. J'entendis crier alors «Halt, stehen bleiben !» (Halte-là !). Je me retournai et vis un de ces sbires debout dans la voiture arrêtée devant la demeure des Glowiczower et qui me faisait signe de les rejoindre. Je ne fis ni une ni deux et pris mes jambes à mon cou. J'entendis nettement un bruit de bottes qui me suivait. La peur et mes seize ans me donnèrent des ailes. Arrivé près du coin de la rue du Vautour (quel nom !) je me retournai pour mesurer la distance qui nous séparait. Je vis mon poursuivant qui avait dégainé, viser dans ma direction ... Je n'avais plus qu'à lever les bras et me laisser emmener, non sans violence, dans la voiture dont les trois autres occupants avaient pénétré dans l'immeuble des Glowiczower. Je réalisai alors qu'ils étaient venus chercher la famille qui avait probablement reçu l'ordre de se rendre au camp de rassemblement de Malines comme beaucoup d'autres Juifs mais n'y avait pas obtempéré. Après la guerre, j'allais apprendre que la famille alertée par les cris des voisins qui avaient observé aux fenêtres la course-poursuite dont j'avais fait l'objet, avait eu le temps de sauter le mur du jardin. J'appris hélas aussi qu'ils avaient été arrêtés par la suite et étaient morts en déportation. J'avais donc été pris à leur place, pour rien. Conduit à
Ma chute fut amortie par les bras d'une jeune fille qui attendait avec ses parents et d'autres victimes de connaître le sort qui allait nous être réservé. Je me souviens que dès le premier contact un courant de sympathie naquit entre elle et moi. Elle m'apprit qu'elle avait 18 ans et était étudiante tout comme moi. J'avais deviné en elle une sensibilité assez romantique qui correspondait à mon tempérament. Comment expliquer que, assis à ses côtés, je me sentis un peu rassuré. Pourtant ce qui venait de m'arriver était extrêmement inquiétant. J'étais coupé de ma famille, d'un foyer où j'avais grandi, aimé, rêvé à mille projets, où j'avais vécu insouciant... Si ce n'est les derniers temps où le malheur semblait vouloir s'infiltrer en mon esprit. J'avais vu à la devanture d'une librairie que je fréquentais assidûment un livre intitulé Mein Kampf d'Adolf Hitler dans la traduction française. Intrigué par son contenu qui devait m'apprendre ce que ce diable d'homme avait dans la tête, je parvins un jour de grande fréquentation de la librairie à le feuilleter à la dérobée. J'eus le souffle coupé lorsque je découvris le chapitre relatif à la destruction du peuple juif, dont la lecture mit un terme à ma curiosité. Cet homme était donc vraiment atteint de folie. Ainsi toutes les mesures prises à notre égard avaient bien un but déterminé. J'en faisais la triste expérience aujourd'hui. J'avais été imprudent. Nous aurions dû fuir, nous cacher n'importe où pour éviter les griffes de cette bête immonde qui n'allait sans doute pas larder à se saisir de mes parents, de mes deux frères. Et cela par ma faute ! Quelle malédiction ! Et dire que dans mon innocence j'avais confectionné dans ma chambre d'appartement un vaste champ de bataille pour mieux savourer les revers de l'ennemi. J'avais acquis une grande carte de l'Europe en couleurs que j'avais attachée au mur de ma chambre et délimitais au moyen d'épingles et d'un cordon les positions de l'armée allemande ville par ville, pays par pays, grâce à la radio clandestine que j'écoutais en cachette chez un camarade. Depuis juin 1942, les revers des Allemands sur le front russe commençaient à faire bouger pour mon plus grand plaisir la ligne du front sur ma carte dans le bon sens. La victoire des Alliés ne me paraissait plus impossible. Et maintenant, quelle défaite pour moi que cette arrestation ! Quel Waterloo ! On aurait dit que Frieda - c'était le nom de la jeune fille qui avait amorti le choc contre les murs de la Gestapo - avait deviné ce qui se passait en moi. Son regard chaleureux et son sourire en ces circonstances m'allaient droit au coeur. Elle ne connaissait rien de moi et pourtant déjà des affinités qui paraissaient étrangères à notre volonté nous rapprochaient étrangement au point que j'en oubliais le lieu même où j'étais tombé. Je n'avais jamais ressenti auparavant pareille attirance avec quelque être que ce fût. Il est vrai que dans ma courte existence j'avais côtoyé peu de jeunes filles. Trois années d'études gréco-latines à l'Athénée royal de Bruxelles qui m'avaient laissé le meilleur souvenir mais où jamais une jeune fille n'avait osé pénétrer. Même pas un lycée de filles à proximité, permettant des rencontres sur le chemin de l'école. Le seul être dont je découvrais régulièrement deux fois par jour la nudité était Manneken-Pis à la sortie de l'Athénée. Je n'avais même pas une soeur qui m'aurait familiarisé avec le mystère du sexe opposé. Il y avait bien les soeurs de mes camarades et les jeunes filles du quartier où j'habitais. Mais vraiment jamais je n'avais éprouvé les sentiments amoureux décrits par mes auteurs de prédilection. Après une nuit d'inconfort et d'incertitude, la dure réalité vint s'imposer de façon brutale et impitoyable. Au matin, notre petit groupe eut le "privilège" de découvrir la Caserne Dossin à Malines, devenue camp de "rassemblement" forcé de toutes ces familles juives. Le camion qui
nous avait amenés pénétra dans la cour de
Des S.S. pour nous accueillir et nous conduire dans la "Salle d'Accueil" où nos papiers étant confisqués, nous fûmes dépouillés de tous nos objets et valeurs quelconques. Et pour s'assurer que rien ne manquait, nous fûmes soumis à la fouille corporelle. Moi du côté des hommes, Frieda du côté des femmes, nous nous sommes retrouvés nus comme des vers et pliés en deux pour un examen des parties de notre anatomie susceptibles de cacher quelque objet de valeur. La vue de sa nudité, de cette humiliation me mit la rage au coeur. J'éprouvai un sentiment d'impuissance face à ces êtres immondes, de bête traquée prise dans un piège dont je ne pourrais m'échapper. Sans doute le S.S. «d'accueil» avait-il lu mon dégoût dans mon regard car trouvant que j'avais une chevelure trop belle pour le lieu, il passa la tondeuse dans mes cheveux pour la marquer d'une raie transversale. Répertoriés et numérotés nous fûmes conduits dans une salle où des litières de paille nous attendaient, parmi une multitude d'autres malheureuses victimes. Lever à 6 heures. Déjeuner à 7 heures avec remise d'un croûton de 200 grammes de pain pour la journée. Appel dans la cour à 8 heures. Louche de soupe aqueuse à midi, une cuillère à café de sucre et de confiture avec un breuvage noir qualifié de café le soir et pour couronner le tout, des humiliations et vexations, tel était le programme de la journée de ces familles déchirées et entassées dans la plus infâme promiscuité, sans compter les odeurs pestilentielles vu le manque de lavabos et de toilettes. Dans cette ambiance dantesque, le moral de Frieda ne fléchit pas un instant, attentive sans cesse à soutenir ses parents, à se tenir à mes côtés. Et curieusement dans cette misère, ce monde d'abjection qui n'avait rien pour inspirer l'amour, je découvris grâce à elle, un univers que je n'avais jamais connu ni soupçonné. Très vite, je fus adopté par les parents de Frieda. Nous devînmes inséparables dans l'attente du drame que l'on voyait se profiler à l'horizon. Mon pessimisme quant à l'avenir s'accrut suite à une rencontre que je fis un jour sur la place d'appel, d'un détenu d'allure fort handicapée malgré son âge moyen. Il me rapporta qu'il venait d'arriver du Fort de Breendonck où il avait été torturé pendant des semaines et avait perdu une quarantaine de kilos avant qu'on ne l'envoie en tant que juif poursuivre ailleurs son calvaire via le camp de Malines. Ses bourreaux avaient trouvé que les Juifs n'étaient pas dignes de partager leurs souffrances - quelque atroces qu'elles fussent - avec des non-juifs et que leur sort à Breendonck était trop bon. D'après lui, le plus dur ne faisait que commencer. Le passé, mes parents, mes frères, mes camarades semblaient avoir été rayés de mon existence comme si je savais que je ne les revenais jamais. On aurait dit que mon instinct de conservation me poussait, de peur de perdre l'équilibre, à oblitérer tout ce qui avait contribué à former ma personnalité, mon identité. Je n'appartenais plus à personne, ne possédais plus rien. C'est pourquoi peut-être Frieda était-elle devenue le seul être qui me rattachait à la vie. Nos conversations durant les moments de répit étaient marquées par un penchant commun pour les études qui nous avaient été retirées, ce que nous avions compensé tous les deux par d'abondantes lectures. C'était dans les oeuvres des auteurs classiques que Frieda avait trouvé un champ où son romantisme pouvait puiser des sentiments et se donner libre cours à travers eux. Quant à moi, mes lectures avaient été plus centrées sur des ouvrages qui répondaient à un besoin de comprendre l'existence, le monde, même s'il pouvait paraître hostile. Frieda semblait émerveillée de m'entendre parler de Kant, Leibniz, Schopenhauer, bien que mes connaissances fussent assez superficielles. Elle appréciait tout particulièrement que j'avais écrit un petit ouvrage intitulé "Traité de la Vie de la Matière" en plusieurs chapitres opérant la démonstration que la matière aussi était dotée de vie. Ce texte, je l'avais d'ailleurs en poche pour le montrer à mon ami Glowiczower et les Allemands l'avaient confisqué lors de mon arrestation. Frieda me dit que j'avais écrit ce texte tout simplement parce que j'aimais la vie et que moi aussi j'étais un romantique. Noire soudaine et chaste passion éclose dans ce lieu de détresse et de promiscuité fut frappée de plein fouet par un incident tout à fait inattendu en cette galère. Un matin, lors de
l'appel de tous les détenus dans la cour de
La cravache à la main, il l'invita d'un geste à sortir du rang et à attendre qu'il ait terminé son inspection. Après nous avoir tous renvoyés dans nos dortoirs de misère, il se retourna vers Frieda et lui enjoignit de le suivre. L'inquiétude des parents alla croissant de minute en minute et l'attente de nouvelles de Frieda parut interminable. Enfin, après une heure d'angoisse fébrile elle réapparut. Le commandant lui avait proposé un marché : elle devenait sa maîtresse et ses parents étaient libérés ou bien... ils étaient tous les trois envoyés en déportation avec le prochain transport. Leur réponse fut immédiate et cinglante comme la mort : ils partiraient ensemble en déportation. Cet événement exacerba encore plus la passion muette et criante à la fois que nous vivions, Frieda et moi. Un même destin semblait vouloir maintenant nous lier plus étroitement. Ce jour-là, je priai pour que le sort fasse que je sois du même convoi de déportation que Frieda. Ce qui m'impressionnait beaucoup chez elle, c'était de voir cette jeune fille dont chacun remarquait la beauté, devant appartenir à un milieu très aisé, faire preuve d'un courage et d'un moral à toute épreuve. C'était elle, qui en ces pénibles journées apportait sans relâche à ses parents un baume sur leurs plaies de plus en plus profondes. Deux jours plus tard, le 11 septembre 1942 au malin, tous les détenus étant réunis dans la sinistre cour de la Caserne, mille noms d'enfants, parents, vieillards, malades, impotents furent martelés pour le grand départ immédiat du neuvième transport de Malines. Mon coeur battait à se rompre... Hourrah ! J'étais du voyage avec Frieda et ses parents ! Nous fûmes tous embarqués comme du bétail dans des wagons dont le confort lamentable semblait avoir été préparé spécialement pour nous autres, Juifs. Destination, inconnue... Trois jours et trois nuits de misère, d'inquiétude, de cris et de pleurs qui ne faisaient augurer rien de bon pour l'avenir. Et partout, des gardiens en armes qui nous épiaient comme des fauves. Frieda et moi, durant tout ce trajet nous nous tenions enlacés pour être sûrs que rien ne puisse nous séparer. Nous n'avions pas besoin de beaucoup de paroles pour nous comprendre. Les mots étaient devenus inutiles, dérisoires. Je me suis souvenu alors qu'avant mon arrestation j'avais mis à profit mon temps d'oisiveté pour me plonger dans des bouquins de philosophie élémentaire qui m'attiraient sans doute vu les circonstances, les frustrations de toutes sortes et que j'avais été particulièrement intéressé par la philosophie stoïcienne. Je me suis dit que c'était peut-être par prémonition. Je me remémorais à présent certains aphorismes de Zenon et de Marc-Aurèle qui m'avaient surtout plu par la faculté qu'ils donnaient à l'individu de se rendre insensible à la douleur, comme par un tour de magie de l'esprit. Cette sagesse m'était d'autant plus précieuse qu'elle rejoignait les principes d'éducation qu'un de mes anciens professeurs d'Athénée m'avait inculqués. Il fondait tout son enseignement sur les venus de la volonté de ses élèves qu'il n'avait de cesse de vouloir développer en eux. C'était peut-être le moment ou jamais de mettre en application toutes ces belles théories. Je n'allais cependant pas tarder à apprendre que la philosophie n'était pas toujours payante. A l'aube du quatrième jour, le train étant à l'arrêt, nous fûmes réveillés par des cris en allemand : tous les hommes de 16 à 40 ans devaient descendre ! Personne dans le wagon ne bougea, dans l'appréhension de ce qui allait se passer. Les cris gutturaux redoublèrent et soudain la portière s'ouvrit. Un militaire allemand monta dans le train et avant que je puisse réaliser ce qui m'arrivait, me voilà projeté dehors malgré l'étreinte puissante de Frieda, pour me retrouver à même le sol. Nous étions là une centaine d'hommes et aussitôt les portières se refermèrent, le train se remit en branle nous laissant sur le quai abasourdis, amputés des êtres qui nous étaient chers et qui nous avaient tenus au chaud, en proie aux plus vives inquiétudes, au plus noir chagrin. C'était la fin de notre voyage... et le commencement de ce qui allait être l'extermination la plus ignoble de l'histoire de l'humanité. J'ai maudit cet affreux gredin qui m'avait arraché à Frieda dans le train. «Tous les hommes de 16 à 40 ans, descendez !», avaient-ils hurlé. Dans le camp, je n'étais qu'un enfant de seize ans, le plus jeune peut-être parmi tous ces hommes venus de différents coins de l'Europe, parmi lesquels il y avait des costauds, des durs à cuire, des débardeurs même, du port d'Amsterdam qui ignoraient leur origine juive, et à côté desquels je faisais figure de gringalet. Et tous, le crâne rasé, immatriculés, nous étions condamnés aux travaux forcés les plus lourds. Les autres, les femmes, les enfants, les plus de quarante ans et les vieillards restés dans le train avaient été considérés comme inaptes à ces travaux. Je me disais sans cesse que ma place aurait dû être parmi eux, près de Frieda, qui devait connaître un sort meilleur que celui de cet enfer ! Durant les premiers mois, ma douleur de l'avoir perdue fut plus forte que tout ce que j'endurais physiquement. Les coups, la faim, le froid, la fatigue n'estompaient en rien mes regrets. Bien au contraire. Nous nous demandions tous ce qu'étaient devenus ceux à qui on nous avait arrachés. Et l'univers concentrationnaire dans lequel nous nous débattions ne laissait filtrer aucune réponse a nos questions angoissantes, aucun souffle extérieur à travers ses clôtures électrifiées. L'imagination alla bon train au début, échafaudant les possibilités les plus chimériques pour ne pas perdre le moral mais très rapidement les hécatombes parmi les nôtres ne laissèrent que très peu d'illusions. Très vite aussi, je compris que je me trouvais dans un monde de cruauté sans logique, où l'on tuait pour un oui, pour un non, ne laissant aucune place aux beaux sentiments que l'on m'avait inculqués. Je pensais souvent que j'étais tombé sur une autre planète dont je ne m'échapperais jamais et regardais mes bourreaux presque avec pitié. Avec le temps et les blessures, décharnés comme nous l'étions, seule la pensée de notre propre survie nous fut encore accessible. Je me répétais chaque matin, au moment du départ pour la «Baustelle» (le chantier), que si je survivais à cette journée, je serais sauvé. Et même si je devais mourir, ce ne serait pas grave, la vie n'étant dans mon esprit qu'une petite étincelle devant l'éternité, et la mienne n'ayant fait que s'éteindre plus rapidement. Peu à peu, l'image de Frieda s'estompa dans le brouillard de mon esprit tenaillé par la faim lancinante et le combat de chaque instant. J'ai même cru à un certain moment que ma dernière heure était venue, que je ne reverrais plus Frieda - si elle était encore en vie - ni ma famille, ni personne. C'était en janvier 1945. Je me trouvais au camp de concentration de Blechhammer en Haute-Silésie. L'hiver était rigoureux et mes forces sérieusement épuisées. Ce qui nous donnait pourtant du courage, ranimait même des mourants, c'était le son du canon, encore lointain mais se rapprochant de jour en jour. L'Armée rouge que l'on attendait depuis des mois, que l'on suppliait en prières de venir nous délivrer, semblait enfin à proximité. Nos gardiens S.S. étaient de plus en plus nerveux. Il nous paraissait inconcevable qu'ils acceptent que nous autres Juifs, à qui ils vouaient une haine féroce, ayons un jour la vie sauve. Les Russes ne seraient plus qu'à une trentaine de kilomètres de notre camp ! L'émotion atteignit son comble et nous nous préparions au meilleur comme au pire, plutôt au pire. Chaque heure était comptée. Il s'agissait de tenir coûte que coûte. Le 14 janvier au matin, rassemblement général et ordre d'évacuation du camp nous fut donné ! Quiconque n'obtempérerait pas serait abattu sur place. C'était le sauve-qui-peut chez nos bourreaux mais pour nous la grande désillusion. Tous nos espoirs, nos rêves d'une libération, presque incroyable, s'évanouissaient si près du but ! La couverture sur le dos et comme seul viatique un pain de 400 grammes, nous fûmes 4.500 forçats à franchir le portail du camp sous les coups de crosse de fusil pour hâter notre pas. Nous entendîmes nettement les coups de feu derrière nous qui achevaient ceux qui avaient choisi de se cacher, ou de mourir plutôt que de souffrir encore. Au préalable, j'avais sorti de sa cachette un trésor que je conservais dans ma paillasse depuis près d'un an et qui par miracle avait échappé aux vols de voisins "bienveillants" et aux fouilles des S.S. Ce trésor, c'était deux sachets de 250 grammes de tabac chacun que j'avais acquis dans des circonstances inoubliables et que je gardais précieusement comme une bouée de sauvetage. Cette fortune, je la devais à mon professeur de mathématiques, Monsieur Marcel Dupont, que je n'oublierai jamais. Un jour de janvier 1944, je déchargeais d'un train sur le chantier des sacs de ciment sous la surveillance de S.S. M'étant rendu aux latrines pour me soulager d'un besoin, je croisai en chemin un homme d'une trentaine d'années qui me demanda si je parlais français. Lui ayant dit que j'étais belge, il me fit part de ce qu'il était originaire de Bruxelles, travailleur obligatoire. Sans doute apitoyé par mon état physique, il sortit de son sac un morceau de pain qu'il me tendit. De plus, il me signala qu'il partait en congé le lendemain à Bruxelles pour une quinzaine et me demanda, à ma grande surprise, si je n'avais pas un message à remettre à quelqu'un qui pourrait m'aider. La question me fit bondir de joie, mais à la réflexion je ne voyais pas très bien à qui m'adresser. Mes parents n'étaient certainement plus à l'adresse où je les avais laissés si eux-mêmes n'avaient pas été déportés. Le rationnement en Belgique ne devait pas laisser du superflu et trouver quelqu'un, en ces temps difficiles, qui prendrait le risque de remettre un colis à un inconnu, n'était pas chose facile. J'eus tout à coup une idée lumineuse en songeant à l'homme que j'avais estimé le plus pour son intelligence, son énergie et sa correction, et auquel j'avais souvent pensé comme modèle de volonté dans les moments les plus durs que je venais de connaître : mon professeur de mathématiques, Monsieur Marcel Dupont. Pour ne pas trop compromettre mon interlocuteur au cas où il serait fouillé, je griffonnai rapidement sur un papier qu'il m'avait tendu ses nom et adresse et quelques mots pour lui dire que je ne me portais pas trop mal.... mais qu'un petit colis ne me ferait pas de tort. Nous nous séparâmes furtivement et je m'en allai incrédule. Une quinzaine de jours plus tard, toujours occupé au même endroit à décharger des wagons, j'aperçus mon homme sur le quai, me faire discrètement signe de venir le rejoindre. N'ayant pas encore ce matin-là usé de la permission de me rendre aux latrines, celle-ci me fut accordée. Quelle ne fut pas ma surprise de le voir me remettre un colis avec un mot d'encouragement de mon professeur. Ainsi donc ces deux hommes avaient pris des risques considérables pour me venir en aide. J'en pleurai de joie. Mais en même temps je fus pris de panique à l'idée du danger mortel de réintégrer le camp dans la soirée avec un paquet compromettant. Rapidement, j'ouvris le colis et remis à mon sauveur toutes les boîtes de conserves qu'il contenait, me contentant d'un paquet de biscuits et de deux paquets de tabac que je glissai dans l'ouverture de ma chemise. Le tabac au camp était considéré comme très précieux et mes paquets représentaient quelques pains. C'est en claudiquant et le coeur battant que je franchis ce soir-là le poste de contrôle des S.S. à l'entrée du camp. Le lendemain, je fus envoyé sur un autre chantier et jamais plus je ne revis mon bienfaiteur qui ne m'avait pas laissé son nom. La marche qui nous fut imposée le 14 janvier 1945 à l'approche de l'armée soviétique fut l'épreuve la plus pénible de toute notre captivité. Je subirais le sort cruel de tous ceux qui ne purent se relever... l'exécution immédiate. C'est à bout de forces qu'à un certain moment je lorgnai vers le S.S. qui fusil à la main marchait à ma hauteur. Ayant sans doute aperçu ma détresse et sentant peut-être venir sa propre fin, il prononça ces quelques mots d'encouragement : «Krieg ist bald aus» (La guerre touche à sa fin). Venant de la part d'un S.S., je n'en croyais pas mes oreilles. Je me remémorai à cet instant précis que je transportais sur mon ventre les deux petits sachets de tabac de mon ancien maître, de mon Dieu. Je plongeai nerveusement la main dans ma chemise, mais ô miséricorde, je ne retirai qu'un papier vide : le tabac avait séché sur mon ventre et s'était complètement échappé par une déchirure. J'attrapai l'autre sachet qui, lui, était intact et le proposai à mon S.S. Après l'avoir ouvert et examiné, il sortit de sa besace un pain qu'il me remit après s'être assuré qu'aucun autre gardien ne pouvait l'observer. J'étais sauvé ! Du moins provisoirement. Mon trésor bien gardé m'avait servi à point et permis de survivre à cette épreuve surhumaine qui avait abouti aux portes du camp de Buchenwald, de triste mémoire. Là, nous fûmes parqués dans les baraques des «Cadavres Ambulants» avec interdiction formelle de sortir du bloc réservé aux Juifs qui nous était assigné. Nous devions au manque de combustible d'avoir échappé aux flammes du four crématoire. Aucun répit cependant ne nous serait accordé. Quelques semaines plus tard, on put entendre le son du canon résonner allègrement dans le lointain. Cette fois, c'était celui de l'armée américaine. Tout le camp était en effervescence. Mais c'était sans compter encore avec la haine implacable que les S.S. vouaient aux Juifs. Nous en avions fait suffisamment l'expérience. Ils nous donnèrent l'ordre de sortir du baraquement où nous étions entassés, et veillèrent à ce que même les cadavres en soient extraits, amoncelés près de la porte. Vu mon état d'épuisement total, mon choix fut fait sans hésitation. Je mourrais sur place plutôt que de reprendre la route. C'est ainsi que poussé dehors à coups de trique, je me laissai choir sur le monceau de cadavres, tandis que mes camarades étaient mis en rangs. A ma grande satisfaction, je sentis sur moi le poids et la froideur d'autres cadavres qu'on venait d'apporter. La mort me serait-elle venue en aide ? Je restai ainsi coincé de longues minutes, le coeur battant plus fort que jamais. J'entendis distinctement les cris des S.S. mettant en marche toute la colonne d'éclopés vers la sortie du camp. Après un brouhaha intense, un profond silence s'installa qui me laissa hésitant. Fallait-il ressusciter et chercher à me planquer quelque part ou attendre des conditions plus favorables ? Retourner dans la baraque vidée de mes malheureux compagnons était exclu. L'odeur pestilentielle me décida à me dégager avant que l'on ne vienne pour la faire disparaître. C'est à ce moment précis qu'un Kapo (chef de détenus) de passage m'aperçut en train de m'extraire et me cria de venir le rejoindre. Rassemblant toute mon énergie, je me précipitai dans le sens opposé pour atteindre les baraques des prisonniers non-juifs, pour nous interdites, où haletant je m'engouffrai dans la première venue. L'un des occupants vint à moi, intrigué par mon désarroi et devinant sans doute à mon allure et à mon insigne juif que je faisais partie du groupe des «Cadavres Ambulants» dont il avait pu apercevoir l'entrée macabre dans le camp un mois plus tôt. «Que se passe-t-il ?», me demanda-t-il en français. Je le mis au courant de ce qui venait d'arriver à mes camarades et à moi-même. Ayant appris que je venais de Bruxelles où j'avais été étudiant, il me fit part de ce qu'il était tout comme moi Bruxellois, étudiant en Droit, et qu'il s'était fait arrêter avec son père comme membres de la Résistance. Me sachant en danger, il m'invita à me cacher sous la planche près du sol qui lui servait de grabat et me remit une tranche de pain. Ce geste me toucha profondément. Il veilla pendant quelques jours à ma clandestinité et partagea avec moi sa maigre pitance. Ses encouragements à tenir encore, si près du but m'insufflèrent quelque énergie. Son nom est André De Raet. C'était pour moi la confirmation qu'il existait des êtres d'exception. Ma bonne étoile devait veiller sur moi. Car à chaque moment désespéré de mon existence de forçat, un sauveur est arrivé pour me tendre une perche salvatrice. Et curieusement, à chaque fois, ce sauveur était du pays où j'étais né. Je venais encore de l'échapper belle. J'appris en effet que tous mes camarades qui avaient pris la route furent exécutés dans la forêt proche de Buchenwald où ils avaient été emmenés. Et quand quelques jours plus tard vint la libération du camp, le 11 avril 1945, par l'armée américaine du Général Patton, ce jour tant attendu, inespéré, inconcevable, ma faiblesse extrême me laissa presque étranger à la fête, à la joie que l'on criait sur les toits. C'était le comble de la déchéance humaine. Pesant 33 kilos, je fus envoyé dans un hôtel à Weimar en attendant de reprendre quelque énergie, quelque aptitude au rapatriement en avion à Bruxelles. Weimar ! La ville de Goethe et de Schiller. La ville qui incarne le meilleur de l'art allemand, les plus grands écrivains, peintres, poètes et musiciens, située à quelques kilomètres à peine de cette boucherie qu'était Buchenwald. Et ironie du sort, l'arbre sous lequel Goethe aimait s'asseoir et rêver était toujours debout malgré les bombardements comme un défi au monde de la barbarie. C'est dans cette ville de souvenirs du romantisme que je pus approcher quelques jeunes femmes, qui tout comme moi avaient survécu au malheur et attendaient leur rapatriement. Peut-être saurais-je enfin ce qu'il était advenu de ceux que j'avais vus partir sur le quai de cette maudite gare près de trois ans auparavant, ce qu'il était advenu de Frieda. Leur mine ravagée sur un corps malingre criait tout le drame qu'elles avaient vécu. Presque toutes étaient plongées dans un mutisme inquiétant, une tristesse permanente. J'appris par l'une d'elles que plusieurs des jeunes femmes juives présentes à l'hôtel devaient la vie à leur beauté que des S.S. avaient retenue pour en faire leur objet. Et au même moment, j'éprouvai une appréhension de revoir un jour Frieda. Qu'étais-je devenu moi-même ? Plus qu'une ombre squelettique vacillante qui n'avait plus rien à voir avec le jeune garçon qu'elle avait rencontré à peine trois ans plus tôt et qui lui avait parlé timidement littérature, philosophie. Nous risquions tous deux de ne plus nous reconnaître, de ne plus éprouver quelque attirance, qui nous remémorerait les jours passés ensemble où nous voulions lier nos destins jusqu'à la mort. Je craignais que nous ne soyons devenus deux êtres brisés qui ne se regarderaient que comme deux étrangers, le regard voilé par la noirceur de la mort que nous avions côtoyée si longtemps. Et pourtant, je gardais encore malgré tout au fond de moi l'espoir de retrouver un peu de ce sourire, de cet élan vers moi qui m'avaient tellement troublé. Mon retour à Bruxelles devait me fixer très rapidement. J'appris avec stupeur la nouvelle horrible, le sort affreux que personne n'avait osé imaginer. Frieda, ses parents et leurs compagnons d'infortune avaient vu leur destin scellé dans des chambres à gaz à Auschwitz dès leur arrivée pour ne laisser derrière eux, comme mes parents, comme des millions d'autres victimes, qu'une traînée de fumée ... qui ne s'estompera jamais. La gorge serrée, je revis en pensée le film de notre rencontre à la Gestapo, des liens désespérés noués en cette sinistre Caserne Dossin, l'antichambre de la mort, de cette déchirure sur le quai d'une gare en Pologne, qui m'avait tant fait souffrir et de cette fin atroce dans une chambre à gaz pour mettre un terme à son existence. Adieu Frieda, toi qui m'as fait découvrir l'existence de l'amour. Un amour qui, venant à peine de naître, devait déjà mourir de façon ignominieuse. Peut-être qu'inconsciemment, t'ai-je cherchée partout, en vain, jusqu'à ce jour. Et sans doute est-ce l'explication du nombre de jeunes femmes connues et presque sitôt oubliées... Sache que notre brève rencontre aura laissé en moi une empreinte telle qu'en ce jour de réminiscence de l'Holocauste, je n'ai pu garder plus longtemps sous silence, malgré une pudeur que tu aurais appréciée, un témoignage de l'abjection qui m'a tenu beaucoup à coeur depuis plus de cinquante ans. Le 13 mai 1994. |